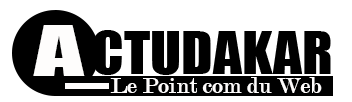Le financement public ne représente toujours que 26 % de la dépense courante en santé
L’Organisation mondiale de la santé (Oms) vient de publier la Matrice des progrès en ma‐ tière de financement de la santé au Sénégal pour l’année 2024.
Au cours des deux dernières décennies, le Sénégal a réalisé des progrès remarquables pour atteindre l’objectif de couverture de sanitaire universelle. En effet, le taux de couverture en services essentiels qui est passé de 21 en 2000 à 50 en 2021, selon l’Oms. Un indicateur im‐ portant mis en avant par les en‐ quêtes auprès des ménages montre même que les barrières à l’accès aux services de santé s’estompent progressivement, avec une proportion en nette progression de la population ayant déclaré une maladie ou une blessure et ayant consulté un professionnel de santé étant en nette progression : elle est passée de 23,5 % en 2014 à 60,7 % en 2019. Néanmoins, ces bonnes performances sont à nuancer. D’abord parce qu’il existe encore une forte propension à ne pas recourir aux soins parmi les groupes de population les plus défavorisés.
Si l’accès aux services essentiels s’améliore dans le pays, le diffé‐ rentiel d’accès entre les quintiles de revenus les plus riches et les plus pauvres restent conséquent. Par exemple, pour un service révélateur de la performance du système de santé comme tel que la consultation prénatale, la différence est de plus de 50 points de pourcentage. Ensuite, parce que cette amélioration en termes de couverture de service s’est accompagnée d’une dégradation de la protection financière lors de recours aux services de santé. Ainsi, la proportion de ménages qui dépensent plus de 10 % de leur budget pour des services de santé est passée de 1,6 % en 2000 à 6,9 % en 2018, selon le rapport mondial de suivi de la couverture universelle. Et là encore, les problèmes d’iniquité sont importants puisque les ménages les plus pauvres (quintile 1) courent 4,4 fois plus de risque de faire face à des dépenses catastrophiques de santé que les ménages les plus riches (quintile 5), et ceux résidant en milieu rural ont 3,3 fois plus de chance d’y faire face que les ménages urbains.
En réponse à ce problème, le pays a mis en œuvre depuis 2017 une Stratégie nationale de financement de la santé couvrant une période de cinq ans, qui vise non seulement à améliorer l’équité dans l’accès aux soins, mais aussi à améliorer la performance du système de finance‐ ment de la santé pour mieux protéger les populations contre le risque financier lié à la maladie et à mobiliser plus de ressources financières pour tendre vers la Couverture sanitaire universelle (Csu), notamment en mobilisant plus de ressources pour le secteur.
La Matrice de progrès du financement de la santé a été mise en œuvre pour identifier les ef‐ fets de cette stratégie sur les attributs désirables que l’Oms a identifiés pour un système de financement de la santé. Elle met en avant certains leviers que le gouvernement du Sénégal peut utiliser pour améliorer ces performances en termes de protection financière. D’abord, il est important, d’après l’Oms, que le pays sécurise, mais poursuive aussi ses efforts pour augmenter la part publique dans le financement du secteur de la santé.
En effet, au cours des 20 dernières années, les dépenses de santé par habitant ont doublé, mais le financement y afférent a été assuré principalement par des sources privées de finance‐ ment. En effet, entre 2005 et 2015, les dépenses publiques en santé ont chuté, passant de 43 % à 24 % de la dépense courante en santé. En d’autres termes, alors que les dépenses de santé doublaient, le financement public du secteur stagnait. Cette augmentation a donc été principalement financée par, d’une part l’augmentation de la dépense directe des ménages qui a vu sa part relative passer de 39,5 % à 47,3 % entre 2000 et Mise en page 1
021,avecunpicàprèsde55% en 2013 et, d’autre part, par le renforcement de l’aide interna‐ tionale dont le poids est passé de9%en2013à18%dufinance‐ ment total en 2021. Si depuis 2015, le pays a consenti des ef‐ forts pour inverser la tendance baissière, en profitant notam‐ ment de l’effet de la Covid‐19 pour remonter le financement sectoriel à un plus haut niveau de priorité nationale, il n’en de‐ meure pas moins qu’en 2021, soit quatre ans après l’adoption de la stratégie nationale de fi‐ nancement de la santé, le finan‐ cement public ne représente toujours que 26 % de la dépense courante en santé, et moins de 5 % du budget de l’Etat (4,4 % en 2021).
«La situation semble de nouveau se dégrader après l’embellie apportée par la Covid‐19 »
Par ailleurs, la situation semble de nouveau se dégrader après l’embellie apportée par la Covid‐19. Le niveau de dépendance du secteur aux sources de financement privées est pro‐ bablement l’une des causes de la dégradation des indicateurs de protection financière. Néanmoins, il semble que toutes les options pour étendre l’espace fiscal pour la santé ne soient pas encore sur la table du gouvernement. Le levier le plus puissant est la croissance économique, qui permet un élargissement quasi automatique de l’espace fiscal en santé dans un pays où le niveau de prélèvement obligatoire est relative‐ ment important comparé aux pays à niveau de revenus similaires (près de 19 % du Pib en 2021, soit 3,1 points au‐dessus de la moyenne de 33 pays africains, selon l’Ocde). Cependant, les prévisions de croissance sont en deçà des attentes, notamment en raison des tensions politiques ré‐ centes et des retards dans la production d’hydrocarbures. De plus, avec un ratio de 0,47 entre les taxes directes et les taxes indirectes, la structure de la collecte des fonds publics pose également des problèmes de régressivité et donc d’équité dans la mobilisation des ressources publiques pour le financement du secteur qui ne peuvent pas être ignorés.
L’aide internationale, qui semble avoir évité, du moins en par‐ tie, un transfert trop important du coût des services de santé sur les ménages, semble, elle aussi, fluctuante et sans engagement ferme à long terme. La matrice met donc en avant le fait qu’un des leviers les plus efficaces à court et à moyen terme consiste à poursuivre les efforts de consolidation des mécanismes de financement, afin d’améliorer la performance des dépenses publiques en termes de protection financière (à défaut de pouvoir garantir une mobilisation supplémentaire de ressources), ainsi que le ciblage de la dépense publique en santé.
Par ailleurs, à ce jour, il n’existe pas de cadre de collaboration effectif entre les différents or‐ ganismes d’achat permettant de mettre en place des initiatives d’achat groupé ou concerté, et encore moins d’initiatives d’achat harmonisées. L’un des principaux défis sera donc de parvenir à mieux aligner les prestations couvertes (y compris les processus de définition du panier de soins) et les conditions d’accès aux ser‐ vices imposées par les différents mécanismes de financement. Il faudra égale‐ ment s’assurer que les différents acheteurs harmonisent leurs processus de sélection, de contractualisation et de paiement des prestataires de services. Cela explique en partie pourquoi les effets escomptés de ces efforts tardent à arriver. Certaines études montrent en effet que l’adhésion gratuite et automatique aux mutuelles de santé des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale n’a qu’un faible effet sur leur accès aux services de santé – à l’exception notable de l’accou‐ chement en milieu médicalisé‐ et en termes de protection financière.
Nécessité de travailleurs sur une meilleure traçabilité des dépenses dans le secteur
Enfin, dernier élément que la Matrice met en avant : la nécessité de travailler sur une meilleure traçabilité des dépenses dans le secteur, mais aussi une plus grande transparence de son effet en termes d’utilisation des services. Il est difficile aujourd’hui de construire une image d’ensemble des services couverts par les différents mécanismes de financement, et de comparer la prise en charge des patients couverts par ces différents mécanismes. C’est un défi majeur pour les années à venir, d’autant plus que la numérisation du secteur offre une opportunité sans précédent de mieux pouvoir tracer les par‐ cours des patients, et donc de savoir ce que les financements publics ont permis de financer. En termes de processus, la Matrice met enfin en avant le besoin d’une stratégie de financement sectorielle qui propose des lignes d’orientation stratégique plus précises sur la manière de mieux répondre aux défis de la fragmenta‐ tion du financement sectoriel, avec au centre un défi majeur de renforcer les cadres de coordination intersectorielle, notamment entre l’Icamo et l’Anacmu. Elle doit également préciser l’ancrage institutionnel de la stratégie, car l’un des défauts majeurs de la précédente réside dans le fait que le por‐ tage envisagé n’a jamais réellement été mis en place.